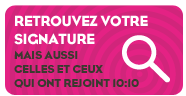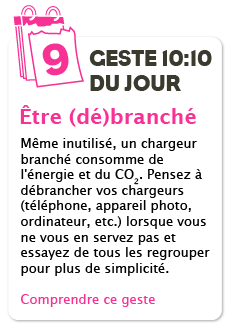8 Décembre 2010 - MEDEF (8H30 – 10H45)
I. Accueil, présentation de la campagne ”10 : 10” et des différents intervenants
Dorothée Martin, responsable du pôle entreprises de la campagne 10 :10 pour la Fondation GoodPlanet a introduit cette conférence en présentant la campagne 10 :10 et en décrivant ses enjeux. Elle a ensuite évoqué les différents outils mis à disposition des signataires : le calculateur d’émissions issu de la méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME, les guides pratiques, le widget d’Action Carbone, le site Internet ainsi que les rencontres. Dorothée Martin a également profité de cette conférence pour présenter la série de posters destinés à sensibiliser les collaborateurs. Ces posters, créés par GoodPlanet dans le cadre de la campagne 10 :10, associent des photographies de Yann Arthus-Bertrand à un ensemble de gestes et de bonnes pratiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans un cadre professionnel. Le discours d’accueil s’est conclu par la présentation des différents intervenants.
II. Introduction
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Agnès Rambaud, votre cabinet est spécialisé dans le déploiement des stratégies de RSE, vous accompagnez entreprises et collectivités sur des dispositifs de sensibilisation/formation pouvez vous poser le décor, nous dire quelques mots sur les enjeux de la sensibilisation et sur ce que vous observez sur le terrain ?
Agnès Rambaud, directrice associée du cabinet Des enjeux et des hommes, a commencé par présenter l’intérêt de la sensibilisation dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour une entreprise. Elle a évoqué quelques caractères généraux que devaient présenter une telle sensibilisation, comme la nécessité d’aller vers un management responsable : il s’agit d’introduire une nouvelle gouvernance, de nouveaux critères dans la prise de décisions, d’avoir une vision à plus long terme et transversale. Elle a insisté sur le fait que les modes de management d’hier ne peuvent permettre de relever les défis du développement durable : il faut réinventer de nouveaux modes de management. Agnès Rambaud a introduit quelques leviers de mobilisation : plateforme collaborative, remonté de bonnes idées, groupes de travail, trophées… Elle a terminé son introduction en insistant sur deux facteurs de succès importants :
- Inscrire la démarche dans un plan global de mobilisation : avoir une réflexion sur les cibles prioritaires et sur la planification dans le temps,
- Inscrire les actions dans la durée et continuer de les animer de manière pérenne : exemple de la campagne 10 :10.
Agnès Rambaud a ensuite donné la parole à Jocelyne Leporatti pour qu’elle complète ses propos.
Jocelyne Leporatti, présidente fondatrice du Club Génération Responsable, a poursuivi cette introduction. Elle a donné les principaux critères de la mobilisation au développement durable. Pour elle, entreprendre cette démarche relève du bon sens. Mais cela nécessite une prise de conscience des chefs d’entreprises et des collaborateurs proches. Grâce à son Club, Jocelyne Leporatti a évoqué l’intérêt des réseaux et le fait que beaucoup d’entreprises communiquent sur leur retour d’expérience. Mais elle a également soulevé les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre d’une telle démarche, comme celle de changer les habitudes. Jocelyne Leporatti a terminé en présentant le développement durable comme un formidable levier pour redynamiser les entreprises, aussi bien économiquement qu’au niveau du social ou de l’organisation interne.
III. La communication comme outil de sensibilisation
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Fanny Serre, Aviva, a été une des premières entreprises à adhérer à la campagne 10:10, comment avez-vous utilisé cette opération dans le cadre de la sensibilisation de vos collaborateurs ?
Fanny Serre est responsable Développement Durable chez Aviva, 6ème groupe d’assurance mondial et présent dans 28 pays. Le groupe Aviva s’est engagé dans une démarche développement durable en 2007. Il a pour objectif d’être « carbon neutral » et compense l’ensemble de ses émissions chaque année. Il impose donc à chacune de ses filiales des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aviva France a réalisé son Bilan Carbone® en 2008, puis a élaboré un plan d’action validé par le comité exécutif : le plan concerne l’énergie, le transport, la gestion des déchets et le papier. Un objectif de réduction de 5 % des émissions a été fixé pour l’année 2010.
L’équipe développement durable d’Aviva France a accepté de s’engager dans la campagne 10 :10 anglaise, avant que celle-ci ne soit lancée en France. Cette idée a été perçue comme l’opportunité de lancer une démarche d’animation environnementale et d’implication des collaborateurs au quotidien. L’équipe développement durable n’avait aucun relais de communication auprès des collaborateurs auparavant. Le « défi 10:10 » a donc été lancé pour la branche française d’Aviva, avec l’objectif assigné de réduire de 10 % les émissions de GES à partir de 2010. Dans la mesure où le groupe s’engage à prendre à son compte une réduction de 5 %, il appartient donc aux collaborateurs de réaliser la diminution des 5 % restants.
Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise Aviva a opéré certains aménagements, qui ont parfois nécessité d’importants investissements : salle de télé-présence, système de visio-conférence. Il appartient ensuite aux collaborateurs d’utiliser les moyens qui sont mis à leur disposition pour réduire leur impact environnemental. La démarche de mobilisation d’Aviva se décline en trois étapes :
1 - Information des collaborateurs via l’intranet :
Cela s’est fait par l’intermédiaire d’un formulaire d’implication. Par ce formulaire, chaque collaborateur s’implique sur une ou plusieurs thématiques en fonction de sa sensibilité. Cela permet à l’équipe développement durable de définir des personnes relais sur lesquelles elle va pouvoir s’appuyer pour transmettre les messages par la suite. Lorsqu’un collaborateur s’inscrit, il reçoit une communication spécifique, notamment une newsletter mensuelle. De plus, lorsque qu’un collaborateur s’engage, il reçoit une boîte à outil sur chacune des quatre thématiques. Cette boite à outil se divise en trois parties : les enjeux de la thématique, les actions de l’entreprise dans ce domaine et les astuces ou éco-gestes du quotidien pour un collaborateur. Cependant, l’implication des collaborateurs par ce dispositif a été relativement faible par rapport aux attentes : les personnes qui se sont mobilisées étaient celles qui étaient déjà connues pour leur engagement.
2 - Impliquer les réseaux de distribution :
Les agences Aviva sont en contact avec les clients et ont par conséquent un rôle de sensibilisation beaucoup plus large. Le plus gros réseau du Groupe Aviva est celui des agents généraux qui sont des agences indépendantes et autonomes. Le Groupe ne peut ainsi pas leur imposer quoi que ce soit sur les consommations d’énergie, le papier… Il faut les impliquer d’une façon différente. La démarche de mobilisation lancée très récemment auprès des agents semble mieux fonctionner que celle employée auprès des collaborateurs. La communication se fait grâce à une rubrique dans une newsletter mensuelle. Le premier article de la rubrique était « engagez-vous dans le défi 10 :10 ». La prochaine étape de la démarche est la distribution d’un guide de l’éco-agence qui vise à répondre à des questions telles que « comment réduire les consommations d’énergie dans les agences ? », « comment réduire la consommation d’eau ? », « comment réduire les déchets ? », « quels sont les éco-gestes au quotidien ? »…
3 - Vers une sensibilisation de façon plus large des clients en 2011 :
L’idée est de faire de cette campagne un outil d’animation commerciale pour Aviva. L’intérêt est d’utiliser cet outil pour se différencier et se démarquer de la concurrence en montrant que les agences s’engagent pour l’environnement. Cela permettra par la suite de relayer auprès des clients les produits « verts ».
Enfin, Aviva met également en place les « buffets 10:10 ». Ce sont des « lunch and learn » au cours desquels les collaborateurs sont invités à venir parler et échanger sur une thématique environnementale autour d’un buffet informel. Une première édition de cet évenement a été organisée au siège en octobre. Il y en aura 3 ou 4 en 2011 avec à chaque fois une thématique différente. L’idée est de sensibiliser, d’animer la démarche et de faire remonter les bonnes idées.
Question de Julie Renauld (Green Dating) : Comment expliquez-vous la faible mobilisation par rapport aux attentes ?
Pour Fanny Serre (Aviva), plusieurs freins existent. D’abord, les outils de communication ne sont pas toujours efficaces : de nombreux collaborateurs ne vont jamais sur l’intranet alors que c’est le premier vecteur de communication utilisé par Aviva sur le développement durable. L’équipe développement durable travaille actuellement sur de nouveaux vecteurs de communication pour mobiliser plus d’employés. Ensuite, Fanny Serre a remarqué que plus le nombre d’employés sur le site est important, moins l’implication des collaborateurs est forte. Il semblerait qu’ils soient plus individualistes et se sentent moins impliqués. Il s’agit là d’un frein important.
Question : Quels ont été vos résultats suite au travail de sensibilisation à travers les « buffets 10:10 » ?
Pour l’instant, l’équipe développement durable d’Aviva n’a organisé qu’un seul « buffet 10:10 » au siège, évènement qui a rassemblé une trentaine de personnes. Ces « lunch and learn » ont été lancés pour les gens inscrits au « défi 10:10 », donc déjà sensibilisés. Ils ont été invités à venir avec un collègue qui n’était pas engagé dans la démarche, dans le but d’impliquer de nouvelles personnes. Les prochaines éditions seront ouvertes à l’ensemble des collaborateurs, dans la limite des places disponibles. La démarche a généré de bonnes surprises : à Rouen, cet événement a impliqué plus de 50 personnes sur les 230 collaborateurs du site. C’est le signe d’un véritable intérêt pour ce sujet sur ce site, où une « correspondante environnement » a d’ailleurs été nommée pour animer la démarche au plus proche du terrain.
Question : Est-ce une première étape d’une sensibilisation citoyenne pour aller vers une démarche globale de sensibilisation de la part d’Aviva envers ses clients ?
Fanny Serre (Aviva) a répondu que dans la pratique, l’équipe développement durable travaille essentiellement sur trois volets, chacun nécessitant une modification du fonctionnement interne de l’entreprise : la sensibilisation des collaborateurs, des agents, et dans un troisième temps des clients. Dans ce dernier cas, le travail de sensibilisation touche surtout aux « produits et offres » : comment, en tant qu’assureur, peut-on inciter les clients à changer leur comportement et les récompenser ? L’exemple le plus simple est celui de l’assurance automobile : une réduction des cotisations est offerte pour les véhicules plus propres ou pour les gens qui roulent moins. Aviva essaie également d’inciter les clients à réaliser des travaux d’isolation par l’intermédiaire de l’assurance habitation. Il existe d’autres exemples : le pack « vélo-cité », le pack « transports en commun » ou encore le pack « énergies nouvelles » pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Le groupe réfléchit à de nouveaux leviers pour modifier plus encore le comportement de ses clients et ainsi promouvoir le covoiturage ou la compensation carbone par exemple. En ce qui concerne l’épargne et l’assurance vie, Aviva essaie d’orienter les clients vers des investissements socialement responsables. Les démarches de mobilisation interne et de sensibilisation des clients doivent être mises en place en parallèle pour maintenir une bonne cohérence dans l’entreprise.
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Jon Lambe, vous avez profité de la journée internationale de lutte contre le changement climatique pour réaliser pendant une semaine une série d’événements à l’ambassade de Grande-Bretagne. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Jon Lambe travaille à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris et est deuxième conseiller - Climat et Energie.
1 - Le contexte britannique
La campagne 10:10 a été lancée au Royaume-Uni en 2009 et très rapidement plusieurs ministères britanniques ont adhéré à l’opération. Suite à l’élection du nouveau gouvernement en mai, il a été décidé qu’il s’engagerait dans son ensemble dans la campagne, avec un objectif global de réduction de 600000 tonnes de CO2. Le ministère des Affaires étrangères britannique a été l’un des premiers à s’engager. 73 ambassades ont suivi le mouvement dans le monde. L’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris, qui emploie 250 personnes, fait partie de celles-ci.
La campagne 10:10 ne représente qu’une partie des objectifs que la Grande-Bretagne s’est fixé à plus long terme. Le ministère des Affaires étrangères britannique s’est engagé à devenir « carbon neutral » d’ici à 2020. Une équipe basée à Londres soutient et conseille les différentes ambassades sur les actions à entreprendre pour réduire leurs émissions de GES et les aide à réaliser leur Bilan Carbone®.
2 - Les actions concrètes de sensibilisation à l’Ambassade
Il y avait déjà deux initiatives lancées avant l’engagement dans campagne 10:10 :
- la sensibilisation pour éteindre les appareils électriques, les ordinateurs et les lumières ;
- la sensibilisation au tri des déchets lors de la mise en place des points de tri.
D’autres actions ont été organisées en parallèle de la mobilisation. Ainsi, la chaudière et le système de contrôle du chauffage ont été remplacés. Cela a permis de réduire de 20 % les émissions associées à ce poste. D’autres exemples peuvent être cités : un véhicule hybride est venu en remplacement d’une voiture classique, et la politique de transports (notamment pour les trajets Paris / Londres) est essentiellement basée sur l’utilisation du train et non de l’avion.
La sensibilisation et l’information des collaborateurs sont tout aussi importantes, car elles doivent concrétiser les actions et les politiques entreprises en matière de développement durable. Ainsi, pour la journée du 10:10:10, l’Ambassade a organisé une semaine d’événements : la présentation des efforts entrepris par l’Ambassade, une exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand, un atelier « ampoules basse-consommation », un cocktail autour d’une boisson verte pour favoriser le dialogue sur les thèmes du développement durable…
Comme toutes les ambassades, celle de Paris a un objectif de diplomatie publique. Dans ce cadre, plusieurs vidéos ont été mises en ligne durant cette semaine, expliquant comment l’ambassade contribue à la lutte contre le changement climatique.
Il convient de signaler qu’avant même son engagement dans la campagne, l’empreinte carbone de l’ambassade était plus faible que celle de ses homologues, en particulier grâce à l’existence de l’Eurostar entre Paris et Londres et au réseau de transports en commun parisien qu’emprunte la plupart des collaborateurs.
Le gros désavantage de l’Ambassade de Paris a trait à son bâtiment ancien et classé, ce qui rend impossibles les changements structuraux comme des travaux d’isolation, un changement plus important du système de chauffage, l’installation de panneaux photovoltaïques, ou l’installation de double vitrage.
3 - Les prochaines étapes
L’ambassade entend continuer les actions concrètes. Elle est en train de remplacer les ampoules traditionnelles par des ampoules « basse-consommation ». La sensibilisation est également une démarche qui doit être poursuivie sur le long terme : il est très difficile de changer les habitudes des gens.
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Marianne Buhler, la ville d’Issy-les-Moulineaux vient tout juste de signer la campagne 10 :10. Cette signature est dans la lignée des actions entreprises depuis plusieurs années en matière de développement durable. Vous avez récemment choisi d’impliquer les agents de la ville dans la lutte contre les gaz à effet de serre, pouvez-vous nous expliquer comment ?
La ville d’Issy-Les-Moulineaux dont le maire est André Santini a signé la Charte 10:10 le 2 décembre. Marianne Buhler, adjointe au maire, anime la délégation développement durable qui existe depuis 2 ans et demi. Cette politique développement durable a été mise en place dans un contexte de scepticisme, autant au niveau des élus que des agents. Les principales critiques concernent des problématiques de coût et de rentabilité. Marianne Buhler a repris l’idée qu’il faut arrêter de culpabiliser mais plutôt responsabiliser les gens, en ajoutant qu’il est même nécessaire de séduire en essayant de positiver le concept de développement durable et voir comment il peut être un plus pour chacun.
La ville d’Issy a profité du fait qu’elle venait de réaliser son Bilan Carbone® pour utiliser le développement durable comme thème mobilisateur lors de l’assemblée générale des agents de l’année 2010. Cette assemblée a pris la forme d’un « world café ». Sur les 1000 agents, 250 personnes ont répondu présent (ce taux de participation est faible est faible, mais s’explique par la tenue d’une grève le jour de l’assemblée générale). Le « world café » s’est présenté sous la forme de mini-tables rondes de 4 personnes. Les employés à chaque table étaient mélangés, répartis par services et par niveaux de responsabilité différents. Le débat a porté sur quatre thèmes : les déchets, les achats, l’énergie et les transports. Les participants ont disposé de 10 minutes pour discuter et échanger leurs idées à chaque table sur une question donnée. Au bout de 10 minutes, chacun a dû changer de tables et rapporter les idées du groupe auquel il participait précédemment. À la fin de la session, l’ensemble des idées a été collecté sur des « post-it ». L’objectif était d’obtenir un affichage des différentes idées sur un mur. Un dessinateur était également présent pour donner un côté ludique à cette assemblée.
Le premier bilan de cette animation a été marqué par la satisfaction générale des participants. Les collaborateurs ont compris qu’ils étaient force de proposition : 430 idées avaient émergé à la fin de la journée, parmi lesquelles 395 différentes, de la plus pratique à la plus farfelue. Le but était d’accueillir toutes les propositions. Ces dernières ont ensuite été regroupées en quatre thèmes :
- les actions stratégiques,
- les actions exemplaires,
- les actions immédiates,
- les actions prioritaires.
Dans chacun de ces thèmes, les propositions ont été divisées en trois sous-groupes :
- les actions simples à coût nul,
- les actions qui demandent certains aménagements et de faibles investissements,
- les actions qui demandent des investissements importants.
L’ensemble des collaborateurs aura un retour présentant les actions qui ont été choisies en fonction des budgets et de la faisabilité. Pour la mairie, il va s’agir ensuite de créer une émulation entre collaborateurs : outil de calcul pour leurs consommations, coupure de courant pour tous les ordinateurs le soir… Pour mettre en place cette phase, il reste à convaincre les élus.
Cet événement a néanmoins démontré que chacun peut agir en faveur du développement durable et a donc contribué à rendre positive cette démarche auprès des collaborateurs.
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Olivier Seznec, Cisco a été récompensé par Greenpeace pour ses technologies vertes, quelles actions avez-vous mises en place pour que vos collaborateurs aient un comportement « green » ?
Olivier Seznec est directeur technique et responsable du programme « Green IT » chez Cisco, industriel équipementier dans les télécommunications. La société Cisco s’est lancée dans une démarche d’éco-responsabilité en 2006, grâce à une démarche de transformation de l’entreprise. Au départ, le PDG a désigné une structure responsable du développement durable. Elle a défini des objectifs et quatre leviers :
- Diminuer l’impact environnemental des opérations de Cisco
- Travailler sur les produits (production, commercialisation, recyclage)
- Constituer de nouvelles solutions pour les clients : les solutions technologiques de Cisco peuvent aider les autres entreprises à réduire leur impact environnemental.
- Renforcer la culture d’entreprise : implication des collaborateurs dans leur vie professionnelle et dans leur quotidien personnel.
Des indicateurs ont été associés à ces différents leviers, afin de mesurer l’impact des transformations entreprises et les progrès réalisés.
En 2008, un objectif de réduction de 25 % en absolu des émissions de gaz à effet de serre sur la période 2007-2012 a été défini. Ce chiffre concerne la partie « opérations ». Sur la partie « produits », des équipes d’ingénieurs sont maintenant chargées de mettre en place un volet éco-responsabilité pour la phase de conception.
En ce qui concerne la culture d’entreprise, le Groupe Cisco France dispose d’un Comité chargé de mettre en oeuvre un certain nombre d’initiatives. Il s’agit d’actions récurrentes de sensibilisation telles que des conférences mensuelles sur un thème précis, à l’heure du déjeuner, et ouvertes à tous les collaborateurs. À ces occasions, un intervenant externe, spécialiste du sujet traité, vient expliquer la problématique et donner quelques pistes d’action. Ces « Green Days » ont cette année été ouverts aux entreprises voisines. Entre 20 et 80 personnes assistent à ces conférences. Des actions plus ponctuelles ont également été entreprises : l’organisation deux fois par an d’une collecte d’objets avec Emaüs, ainsi qu’une collecte des déchets électroniques des collaborateurs (en vue de leur recyclage) organisée une fois par an, lors de la semaine de l’environnement.
Cisco donne aussi l’opportunité à ses collaborateurs de développer des initiatives individuelles au service de l’entreprise. À ce titre, un groupe de travail sur la rénovation de l’habitat a été créé pour eux. Des réunions régulières avec des maîtres d’oeuvre spécialisés dans la rénovation écologique ont donc été mises en place. Il y a plus d’un an, Cisco a décidé d’installer des ruches sur les toits de son bâtiment. La particularité de ce projet repose sur le fait qu’il est intégralement pris en charge par les collaborateurs. Une équipe de douze personnes a suivi une formation en apiculture, en amont de l’implantation des ruches, en mai dernier. La production de miel s’élève à 100 kg pour la première année. Le miel Cisco a d’ailleurs été récompensé par une médaille d’or au concours des miels d’Île-de-France. Olivier Seznec a démontré que cette expérience, qui de prime abord paraît sans rapport à l’activité de l’entreprise, comporte néanmoins trois avantages majeurs :
- La création d’une équipe transverse : des personnes qui ne s’étaient jamais rencontrées ont travaillé ensemble ;
- L’image de l’entreprise : couverture médiatique lors de la première récolte, amélioration de l’éthique de l’entreprise ;
- L’installation de caméras de surveillance et de capteurs environnementaux sur les ruches. Cisco a travaillé avec un scientifique du CNRS, spécialiste de l’abeille, et qui étudie des points de comportements grâce à ce dispositif de mesure. Cette expérience constitue donc un lien entre le métier de Cisco (technologie de l’information) et les problématiques environnementales.
Cisco aide maintenant d’autres entreprises à mettre en place cette démarche d’installation de ruches (modèle juridique, formation…).
Question de Valérie Ferret (Dassault Systèmes) : L’objectif de réduction de 25 % est-il à l’échelle groupe ou uniquement pour la section France ? Est-ce une réduction brute ou avec compensation ? Est-ce que ce genre d’objectifs « green » rentre dans les objectifs professionnels de certains de vos salariés ?
Pour Olivier Seznec, il s’agit d’un objectif de réduction brute à l’échelle du groupe, décliné ensuite dans chaque pays. Son regret est que ces objectifs ne rentrent pas de manière systématique dans ceux de chaque manageur. Mais ce genre de dispositif devrait voir le jour à l’avenir. Seuls certains collaborateurs, notamment les responsables de pays, ont un objectif assigné concernant les réductions d’émissions de CO2. Un outil de pilotage, les « carbon scorecards », mis à jour tous les trimestres, permet un bon suivi entre les initiatives et la mesure.
Question d’Agnès Rambaud (Des Enjeux et des Hommes) : Quel investissement financier représentent de telles actions (en termes de pourcentage du chiffre d’affaire par exemple) ? Jusqu’à quelle part du CA est-il raisonnable d’aller à votre avis ?
Olivier Seznec a répondu qu’il n’y avait pas de budget particulier dédié pour tout ce qui touche aux transformations. Cisco essaie d’investir lorsque les temps de retour sur investissement sont intéressants. Par exemple, pour la réduction des déplacements, le groupe a initié un vaste plan d’installation de salles de télé-présence. Aujourd’hui, l’entreprise en compte 900 à travers le monde. Le gain est estimé à environ 900 millions de dollars : il s’agit d’économies sur les dépenses liées aux déplacements, soit en moyenne un million de dollars d’économie par salle.
Quant au modèle d’investissement, Cisco pratique le « save to invest » : les économies générées sont réinvesties sur des modèles économiquement viables. Aujourd’hui, la société travaille beaucoup sur le pilotage des énergies dans le bâtiment avec des systèmes de gestion de l’énergie (mise en veille des appareils par exemple). Ce modèle financier n’est pas très ambitieux, mais il correspond à une gestion financière des plus rigoureuses.
IV. Le management comme outil de mobilisation
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Un bon moyen de responsabilisation des collaborateurs semble être la création d’un réseau développement durable associée à une comptabilité environnementale. Olivier Seznec, chez Cisco, quels indicateurs avez-vous mis en place pour remplir vos objectifs environnementaux ?
Olivier Seznec (Cisco) a alors déclaré que son entreprise possède trois outils de mesure de sa performance environnementale :
1 - Un outil américain utilisé pour son rapport RSE. Cet outil est standardisé et consiste à valoriser les réductions d’émissions. Il fait l’objet d’une publication annuelle.
2- Un outil européen, la « carbon scorecard ». Elle inclut trois types d’émissions : les transports aériens, les véhicules de fonction et les bâtiments. Cette mesure est aussi standardisée : tous les trimestres, les pays récupèrent leur « scorecard » et doivent expliquer les différentes initiatives qu’ils mettent en place sur ses trois pôles.
3 - Pour la France, le Bilan Carbone® Ademe est également réalisé afin de pouvoir englober d’autres éléments, notamment les parties « déchets » et « travaux » qui ne sont pas prises en compte par l’outil européen. Ces différents tableaux de bord permettent de constater s’il n’y a pas de divergence entre l’outil européen et la réalité de l’activité de Cisco en France. Le Bilan Carbone® est mis à jour tous les ans.
Question : Olivier Seznec, vous avez beaucoup évoqué les enjeux environnementaux, mais est-ce que cette réflexion s’élargit à une transformation de vos objectifs sociaux et sociétaux ?
Olivier Seznec est essentiellement en charge de l’aspect éco-responsabilité. Cependant, Cisco a lancé des initiatives sur la diversité. Une sous-représentation féminine existe, notamment au niveau du management au sein de l’entreprise. Un groupe appelé « Connected women » est actuellement en charge de créer un réseau d’entraide pour les femmes de la société. Des formations de sensibilisation sur la diversité ont également été apportées au management. Les Ressources Humaines ont travaillé de façon très active sur le handicap. Un plan senior a également été entamé.
Le troisième volet de la partie RSE est le « giving back », qui est la capacité d’impliquer soit des collaborateurs, soit l’entreprise sur des initiatives citoyennes : don du sang, don d’organes, partenariat avec la Fondation Laurette Fugain, accompagnement de chômeurs longue durée. Cisco permet aux collaborateurs de disposer de temps libre, sur leur temps de travail, pour qu’ils puissent participer à ce genre d’actions. L’entreprise s’est également engagée avec un institut de recherche sur la moelle épinière de la Pitié-Salpêtrière : le partenariat consiste à lui fournir des technologies de communication.
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Anne-Laure Marchand, Nature et Découvertes, vous êtes une entreprise pionnière en matière de responsabilité environnementale, comment avez-vous partagé cette responsabilité au sein de votre enseigne ?
Anne-Laure Marchand, responsable bilan environnemental chez Nature & Découvertes, a commencé par évoquer la fonction de réseaux verts créée en 1995. Le réseau vert désigne à la fois la personne et le réseau global. Nature & Découvertes a désigné un réseau vert par magasins, un par service au siège social et un par service aux entrepôts. Le réseau vert est le responsable développement durable de son site, c’est à lui que l’on envoie toutes les informations et c’est lui qui les retransmet à la fois à son équipe, aux clients et aux associations naturalistes qui viennent en magasin. L’emploi de réseau vert correspond à une véritable mission, donnant lieu à une fiche de poste supplémentaire, du temps accordé et une rémunération. Les réseaux verts ont une prime semestrielle sur des objectifs définis en amont, en collaboration avec tous les services avec lesquels ils travaillent. Si les objectifs sont atteints, la prime s’élève à 690 € par semestre. Elle a été mise en place dans les magasins et les entrepôts, mais n’est pas encore pratiquée au siège car l’implication y est plus difficile.
Les réseaux verts mettent en place la politique développement durable sur le terrain. Ils sont en charge de la sensibilisation à la norme ISO 14001 de leur équipe. Une formation leur est dispensée grâce à un module d’e-learning. Ils animent des petits-déjeuners réunions en magasin et disposent pour cela d’outils (quiz, lettre du développement durable qui regroupe toute l’actualité DD de Nature & Découvertes…). Le format des lettres leur permet de les utiliser comme support d’animation pour leurs réunions. Les réseaux verts sont aussi chargés de remplir le tableau de performance environnementale de leur magasin. Ce tableau récapitule les émissions de CO2 associées aux transports domicile-travail de leurs équipes, les notes de frais CO2 qu’ils envoient chaque mois et les déchets traduits en équivalents CO2 (15 filières différentes de tri des déchets existent chez Nature & Découvertes). Les réseaux verts doivent également faire état de leurs activités de sensibilisation.
Anne-Laure Marchand a ensuite évoqué la mise en place du Bilan Carbone® en 2007, point de départ pour Nature & Découvertes de sa volonté d’impliquer tous les salariés dans la démarche. Le reporting de ce Bilan Carbone® est trimestriel. Chaque année, un budget CO2 est fixé pour chaque poste : l’entreprise définit la quantité d’émissions à ne pas dépasser et essaie de les réduire d’une année sur l’autre, dans la mesure du réalisable. Lorsque cela n’est pas possible, elle essaie de les décorréler de la croissance du chiffre d’affaires. Pour impliquer les salariés dans la démarche, le meilleur moyen trouvé a été de leur faire remplir une note de frais CO2. À chacun des déplacements que les salariés effectuent pour le compte de l’entreprise, ils doivent remplir une feuille Excel contenant les facteurs d’émissions associés à leur mode de déplacements. Ces notes de frais CO2 sont collectées par les réseaux verts, chargés ensuite de les envoyer tous les mois au siège. Ces informations étaient déjà disponibles auparavant (par l’intermédiaire des agences de voyages notamment), mais le but des notes de frais CO2 est la sensibilisation directe des salariés. Le bilan est positif, les émissions de CO2 du poste « transport de personnes » sont en baisse constante depuis la mise en place de ce système, sachant que d’autres actions de nature plus structurelles ont été mises en place en parallèle (changement du format des formations notamment).
Question : Quel temps consacrent les employés « réseau vert » à leur mission ?
Anne-Laure Marchand (Nature & Découvertes) a répondu qu’ils y consacrent une à deux heures par mois environ. Mais cela n’inclut évidemment pas la sensibilisation permanente qu’ils effectuent en magasin.
Question : Avez-vous des résultats chiffrés correspondant à vos actions ?
Nature & Découvertes se fixe toujours des objectifs très réalistes. L’entreprise commence par regarder quelles actions elle va mettre en place et quels investissements elle est en mesure de réaliser. Pour le transport de personnes, l’enseigne s’était cette année fixé un objectif de stabilisation : les émissions associées au transport de personnes ne devaient pas augmenter plus que le chiffre d’affaires, avec un seuil fixé à 6%. Pour Anne-Laure Marchand, ces émissions vont largement chuter grâce au changement du lieu de formation. Auparavant, tous les salariés de Nature & Découvertes venaient se former aux techniques de vente et à l’univers des produits à Toussus-le-Noble, en banlieue parisienne, entraînant ainsi de nombreux déplacements et leurs émissions associées. Nature & Découvertes a donc repensé le format de ses formations : l’entreprise a remplacé les sessions de 1 à 2 jours qui avaient lieu plusieurs fois par an par une formation unique d’une semaine qui se déroule une fois l’année et qui regroupe toutes les thématiques. Cela a permis de réduire de presque 39 % les émissions de CO2 liées au poste « formation ». Par ailleurs, cette année, le lieu de formation a été déplacé de Toussus-le-Noble à Versailles. Le nouveau site étant mieux desservi par le train que Toussus-le-Noble qui dispose d’un aérodrome spécialisé dans les voyages d’affaires, ce changement a permis de diminuer de 45 % le nombre de personnes venant en avion au profit du train. Tout cela va donc contribuer à réduire fortement les émissions associées aux déplacements.
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Pouvez-vous nous dire quel est le rôle des réseaux verts dans les projets de votre fondation ?
Nature & Découvertes reverse chaque année 10 % de ses bénéfices nets à sa fondation. La Fondation se compose de deux comités qui sélectionnent une quarantaine de projets par an. Comme les réseaux verts sont les relais développement durable sur le terrain, ils ont chacun pour mission d’aller visiter un projet financé dans l’année. Cela a permis également de réduire les émissions de carbone : auparavant les réseaux verts se rendaient sur les projets en fonction de leurs affinités (parfois en avion) et aujourd’hui, c’est le réseau vert le plus proche qui se déplace (en train de préférence). Sur ce poste, les émissions ont été réduites de 70 %. Ces visites des réseaux verts sur les sites des projets ont un véritable effet positif pour la Fondation car elles permettent à la Fondation d’avoir un vrai retour sur chacun de ses projets. Il est également très motivant pour les réseaux verts de se rendre sur le terrain pour constater les résultats des investissements de la Fondation.
Question : Comment évaluez-vous le transfert de cette sensibilisation auprès de vos clients ? Comment est-ce que les employés de Nature & Découvertes pérennisent cette sensibilisation auprès de vos clients ?
Nature & Découvertes n’a pas de retour quantitatif sur la sensibilisation des clients. L’entreprise ne cherche pas à mesurer l’impact de la politique de l’enseigne sur ses clients. La sensibilisation envers les clients se fait par l’intermédiaire du rapport développement durable, du site Internet et du journal du Club distribué à 350000 adhérents dans lequel Nature & Découvertes communique sur ses engagements et qui contient une rubrique sur le développement durable.
Anne-Laure Marchand a ajouté que les réseaux verts sont en mesure de transmettre la démarche et la politique environnementale auprès des clients. Tous les employés sont également formés à la culture et à l’histoire nature. Donc si le réseau vert fait bien son travail, toute l’équipe est largement sensibilisée.
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Jocelyne Leporatti, l’enseigne Mc Donald en France a mis en place une démarche environnementale, quelle stratégie ont-ils utilisée ? Avez-vous d’autres exemples semblables (Guy Hoquet) ?
Jocelyne Leporatti (Club Génération Responsable) travaille depuis une vingtaine d’années dans le domaine des réseaux, et a constaté qu’un des points forts du développement durable est l’échange et le partage. Au sein du Club Génération Responsable, des enseignes concurrentes n’hésitent pas à travailler ensemble. Par exemple, l’Occitane et Yves Rocher montent ensemble des études sur le sourcing de leurs achats, à l’instar de Truffaut et de Monceau Fleurs ou encore Generali et Allianz. Le développement durable est l’occasion d’aborder de nouvelles thématiques pour lesquelles tout le monde a besoin de réflexion, de trouver de nouvelles idées, de les tester et de les valider. Le fait de pouvoir communiquer, échanger, partager et réfléchir avec d’autres est un point très important.
Dans le cadre des formations que le Club organise sur le terrain pour ses affiliés, une des informations sur lesquelles on insiste très lourdement est d’utiliser les institutions territoriales qui sont à disposition par l’intermédiaire des Chambres de Commerce, des antennes régionales de l’Ademe, des municipalités, par les Agendas 21… Ces institutions permettent un échange et un partage. De plus, lors de ces formations, le Club parvient à réunir différentes enseignes qui ont des activités très proches ou différentes. Par exemple, récemment, à Rouen, des commerçants se sont réunis pour échanger et trouver des bonnes idées et des bonnes pratiques.
Jocelyne Leporatti a ensuite ajouté que l’on retrouve la même chose au niveau des collaborateurs. Il faut un élément moteur et le fait qu’il s’agisse du chef d’entreprise est très favorable à la démarche. Lorsqu’il y a une mobilisation et une prise de conscience de la direction générale, il faut ensuite retrouver ces échanges et ces partages au niveau des collaborateurs. La démarche de développement durable a une transversalité évidente et la réflexion de l’un peut devenir une solution pour quelqu’un d’autre. La motivation, la sensibilisation, la compréhension des collaborateurs passe par tout ce qui est positivité, créativité, échange, partage et anticipation du risque.
La démarche de réduction des émissions est un programme d’amélioration continue et les changements ne se font pas du jour au lendemain. Un facteur important est également le coût économique. Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre génèrent souvent à court, moyen ou long terme des gains économiques, ce qui est le cas dans les programmes d’amélioration énergétique que le Club Génération Responsable a lancés dans plusieurs de ses enseignes.
Par ailleurs, le Club a organisé un concours en avril avec remise d’awards sur différentes thématiques : l’amélioration énergétique, la gestion des déchets, etc. Le but était l’exemplarité : mettre en avant les enseignes qui ont trouvé de bonnes idées et ont obtenu des résultats. Un des gagnants a été Mc Donalds France qui concourrait dans le prix de l’amélioration énergétique. Mc Donalds a en effet mis en place un programme très concret de sensibilisation interne aux économies d’énergie par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 1000 référents sur les 1250 restaurants. Ces référents sont des relais opérationnels de leur stratégie environnementale. Un logiciel développé spécialement pour leurs propres besoins permet de sensibiliser, d’informer et de remonter de l’information. Ce logiciel a permis une interactivité entre les restaurants eux-mêmes, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Ainsi l’ensemble des managers et des équipes des restaurants a été mobilisé. Ces actions ont entraîné un gain de 8 à 15 % sur les consommations énergétiques. Grâce à ce dispositif de mobilisation, tous les employés sont ainsi devenus les acteurs de ce programme d’amélioration. De plus, chez Mc Donalds, 100 % de la consommation d’électricité est couverte par le système des certificats verts.
Les collaborateurs des enseignes doivent également être très bien formés et informés, en plus d’être sensibilisés. Les vendeurs doivent en effet connaître leurs produits, leurs contenus et ce qui est mentionné sur les packagings car ils sont en contact direct avec le consommateur final. Certaines enseignes se lancent aujourd’hui dans des démarches développement durable, mais ne communiquent pas assez sur leurs initiatives et manquent donc parfois de cohérence.
L’enseigne Guy Hoquet Immobilier a également été primée. Cette enseigne comporte 650 agences en France. Aujourd’hui, les agents immobiliers rencontrent beaucoup de problèmes, notamment d’image. Guy Hoquet a eu l’audace de lancer une enquête de satisfaction auprès des consommateurs avec l’agence Ipsos. Les résultats de cette étude ont été plutôt mauvais. La direction de Guy Hoquet a profité de cette opportunité pour revaloriser et redonner du sens au métier d’agent immobilier. Aujourd’hui, grâce à l’affichage environnemental et à d’autres actions, la démarche éco-responsable peut être utilisée pour redonner du sens et valoriser certaines fonctions : les agents immobiliers deviennent ambassadeurs et vecteurs de transmission des bonnes pratiques pour que le client final apprenne à mieux gérer et à réduire ses émissions sur son propre habitat. Guy Hoquet en est encore aux débuts de cette démarche car l’enseigne possède 650 agences et cela représente 3000 collaborateurs à sensibiliser et former. L’intérêt de la démarche est, comme chez Aviva, de voir que les éco-gestes sont d’abord appliqués par la direction générale, puis transmis aux manageurs, ensuite appliqués à l’ensemble des collaborateurs, avant d’être transmis au client final pour arriver ainsi à des réductions d’émissions conséquentes.
Le Club Génération Responsable organise également un « Green Day » le premier jeudi de chaque mois et en est à sa 26ème édition. C’est une journée dédiée à un thème particulier lié au réseau mais parfois très généraliste par rapport aux entreprises. La matinée est consacrée à une conférence-débat qui est ouverte à l’ensemble des entreprises qui souhaitent participer. Les thèmes peuvent être : l’amélioration énergétique, le Bilan Carbone®, l’économie et le développement durable, la sensibilisation des collaborateurs… L’après-midi est consacrée à des commissions de travail réservées aux membres. C’est l’occasion de fédérer un certain nombre de réseaux sur des thématiques qui leur sont propres.
Question de Dorothée Martin (GoodPlanet) : Un autre moyen de mobiliser les collaborateurs est d’utiliser le Web 2.0. Frédéric Poussard, vous êtes fondateur du réseau social Tinkuy, pouvez-vous nous en dire plus ?
Frédéric Poussard a alors pris la parole pour présenter le réseau social Tinkuy. Tinkuy signifie rencontre en quechua, la langue des Incas. Cet organisme est spécialisé depuis deux ans dans le développement et l’animation de réseaux sociaux sur le développement durable. Le principe : la concertation et la mise en relation d’individus font partie intégrante d’une démarche de développement durable. Frédéric Poussard est alors revenu sur quatre problématiques partagées par toutes les personnes présentes à la conférence :
- Comment impliquer les collaborateurs en rendant la démarche à la fois attractive et performante ? L’idée est de convaincre les employés en bas de la hiérarchie ainsi que la direction.
- Comment modérer et trier les bonnes et les moins bonnes idées qui peuvent faire perdre du temps ?
- Comment avoir de la visibilité sur les motivations et l’expertise des volontaires ? Aujourd’hui, les organisations hiérarchiques ne donnent pas systématiquement de visibilité sur ces informations.
- Comment pérenniser la démarche d’implication dans le temps ? Organisation de différents événements…
Pour Frédéric Poussard, le Web 2.0 peut apporter des éléments de réponse assez intéressants sur ces quatre points. Comme pour l’exemple de Mc Donalds, Tinkuy a conçu une offre prête à l’emploi pour pouvoir rapidement lancer un intranet participatif sur les questions de développement durable. Cet outil permet par exemple d’organiser un trophée du développement durable avec une offre clé en main. Une interface 2.0 peut aujourd’hui être assez ludique et la participation peut prendre la forme de jeu-concours. Cela permet de mettre en place des systèmes d’incentive et de reconnaissance. L’intérêt est de valoriser l’implication de chaque salarié et de savoir qui a des compétences particulières sur un sujet donné. Grâce au Web 2.0, cet outil peut offrir tout ce que permet le Web aujourd’hui : tags, liens, vidéos…
Actuellement, les entreprises doivent porter un intérêt particulier à leur réputation numérique, la « e-reputation ». Elles ont donc besoin de mettre en place des indicateurs pour la mesurer. Les entreprises ont beaucoup de difficultés à faire venir leurs collaborateurs sur l’intranet. C’est un des axes de travail qui va se développer dans les entreprises dans les années à venir. Pourquoi ne pas utiliser la démarche développement durable comme un levier fédérateur pour introduire dans l’entreprise ces nouvelles notions de Web 2.0 et de réputation numérique ?
Frédéric Poussard est ensuite revenu sur une statistique représentative : 80 % des gens sont sensibilisés au développement durable, mais seulement 17 % sont impliqués. Tout le monde reporte la responsabilité sur l’autre ou sur un autre service dans l’entreprise. L’intérêt de Tinkuy est que tout le monde va participer à la fois pour publier une idée, pour évaluer sa pertinence, pour l’enrichir, la commenter ou la diffuser. Cette démarche peut également être étendue au consommateur. Il existe une version publique et gratuite, www.sustainatwork.fr où plusieurs centaines de professionnels sont déjà en situation de partage de bonnes pratiques.
V. Conclusion
Pour conclure, Agnès Rambaud (Des enjeux et des hommes) a fait une synthèse des facteurs de succès pour inspirer les actions de mobilisation des collaborateurs :
- Obtenir le soutien (et l’exemplarité) des dirigeants (envisager d’avoir recours au coaching lorsque ce n’est pas le cas !)
- Construire un vrai plan de mobilisation (hiérarchiser les actions et les organiser dans le temps, plutôt que de les lancer de façon « impulsive » ou opportuniste) : identifier les « cibles » clés, les leviers possibles, cartographier les freins et ajuster les moyens en conséquence
- Favoriser au maximum le participatif, à la fois dans l’esprit (encourager la création d’initiatives, ouvrir le champ à une véritable responsabilisation des collaborateurs sans trop cadrer la démarche) et dans la forme (cf. « world café », trophées, plateformes collaboratives...)
- Favoriser la transversalité (entre services, entre entités, en partenariat avec les parties prenantes)
- Communiquer sans cesse sur la démarche (son sens en amont, ses avancées en cours de route, ses résultats en aval) : lui donner un nom (« Défi 10 :10 »), utiliser les canaux de communication classiques (intranet, affichage, newsletter…) et en créer de nouveaux (« green datings », …)
- Mettre en perspective les grands enjeux, ceux du secteur, ceux de l’entreprise ou de la collectivité et des différentes fonctions, faire aussi le lien entre les enjeux business (ou territoriaux pour les collectivités) et ce qui se joue à l’extérieur de l’entreprise (fibre citoyenne)
- Apporter des formations (pour développer les nécessaires compétences) et des outils (kits de déploiement, éco-guides, calculateurs…)
- S’appuyer sur des réseaux de correspondants, relais, référents (les collaborateurs les plus motivés mais pas uniquement…)
- Impliquer les managers pour qu’ils relayent les actions (et ne les freinent pas !)
- Inscrire la RSE dans le système de management (critères de recrutement, de rémunération, d’incentive)
- Travailler avec les DRH (qui sont directement concernées par les changements de culture et de pratiques professionnelles, par l’évolution des organisations et des systèmes de management)
- Mesurer les résultats (et les communiquer car les avancées donnent à chacun l’envie de s’investir pour poursuivre les « efforts » accomplis)
- Travailler sur le « hard » (les politiques, les investissements, les offres de produits…) en parallèle des démarches de mobilisation (dans un souci de cohérence et … de performance).
Agnès Rambaud a finalement félicité la campagne 10 :10 en soulignant qu’il s’agit d’une campagne très positive, preuve que chacun peut agir, que c’est utile et que beaucoup d’acteurs s’engagent. La campagne donne des pistes très concrètes et des indicateurs de mesure grâce au calculateur. C’est une source de motivation.
VI. Questions ouvertes
Dorothée Martin (GoodPlanet) a de nouveau ouvert le débat à toutes les personnes présentes autour de la table ronde.
Jean-Pierre Theret de chez Dassault Systèmes est alors intervenu pour relever un paradoxe. Il a remarqué que l’on demande souvent aux salariés d’être créatifs, positifs, ou encore innovants, mais ils sont bien souvent enfermés dans des initiatives dirigées par le haut de l’entreprise, qui ne fait pas assez appel à leur autonomie, ni les responsabilise suffisamment. Il a donné l’exemple des actions entreprises chez Dassault : un Bilan Carbone®, un nouveau siége HQE… Mais il y a également de nombreuses initiatives qui ont été portées par les employés : création d’un groupe Google en 2007, d’une section d’activité au niveau du CE, d’une commission développement durable plus récemment et d’une commission de restauration qui agit sur l’alimentation. Les employés ont porté tout un ensemble de projets avec l’appui de la communication interne et de la RSE : animation des semaines du développement durable, de la semaine des transports, de la semaine de réduction des déchets, du projet ruches, du carnet de bon usage des bâtiments, de la promotion auprès du prestataire des repas bios et végétariens, de la projection de films, des conférences… Jean-Pierre Theret juge qu’il est donc nécessaire d’avoir une responsabilisation des salariés si on veut assister à l’émergence d’initiatives. Il faut fournir des espaces et des moyens aux salariés pour qu’ils puissent s’organiser, se rencontrer et monter leurs projets. Jean-Pierre Theret a donc demandé aux intervenants s’ils avaient d’autres initiatives susceptibles de donner de la liberté aux salariés.
Jocelyne Leporatti, présidente du Club Génération Responsable, a souhaité répondre et a déclaré qu’il existe de nombreux comités de pilotage créés en dehors des enseignes. Elle a ainsi cité Yves Rocher et l’Occitane. Ces comités de pilotage sont constitués de salariés des différents services qui réfléchissent et font ensuite remonter l’information. Ils fonctionnent souvent très bien. L’information peut remonter ou être échangée entre collaborateurs. Jocelyne Leporatti a ajouté qu’il s’agit également du but des formations multi-enseignes précédemment évoquées que de communiquer ensemble et d’essayer de trouver des bonnes pratiques locales ou nationales.
Fanny Serre (Aviva) a ensuite exprimé son accord avec les propos de Jean-Pierre Theret. Elle a déclaré qu’il est important de laisser s’exprimer la créativité des salariés. Les choses vont beaucoup plus loin que dans le cas où les actions sont initiées au niveau de la direction générale. Cela peut être une difficulté pour les équipes développement durable, souvent en manque d’effectifs. Sur le site de Rouen, la personne qui s’est désignée pour être le relais des thématiques environnementales auprès des salariés travaille avec quelques autres collaborateurs très motivés et elle gère toutes les initiatives mises en place sur le site. Cela fonctionne très bien et même mieux qu’au siège où c’est l’équipe développement durable qui gère cet aspect. Cette personne est en demande d’animations, d’encadrement et d’informations, mais l’équipe du siège n’a pas les moyens de répondre à cette attente et d’animer un tel réseau de salariés.
Agnès Rambaud (Des enjeux et des hommes) a alors déclaré que la démarche développement durable ne fonctionne bien que si le plus grand nombre de collaborateurs s’en empare et innove spontanément. Il faut une génération d’idées et d’initiatives. Jocelyne Leporatti (Club Génération Responsable) a ajouté que ce sont souvent les employés en bas de l’échelle hiérarchique qui trouvent les solutions les plus judicieuses. Elle a alors donné l’exemple d’un fleuriste de Monceau Fleurs qui a trouvé le moyen de consommer moins d’eau pour l’arrosage en utilisant un simple adaptateur.
Brigitte Kahane a alors souhaité prendre la parole. Fondatrice de l’Observatoire de l’Eco design, elle organise les cafés de l’Eco design. Pour elle, il existe une autre façon de mobiliser les collaborateurs : les entreprises ou les enseignes doivent développer des produits, des lieux, des outils ou des services éco-conçus. Les employés sont alors fiers d’appartenir à leur entreprise. Au cours de la conférence, des entreprises ayant mis en place des choses formidables ont été présentées. Mais elles partent d’une activité ou d’une offre préexistante, sur laquelle elles ont entrepris une démarche développement durable : il a fallu qu’elles cherchent à optimiser, à s’améliorer et à être vertueuses. Il existe aussi des PME qui se sont différenciées ou se sont créées autour de projets durables. Brigitte Kahane estime que pour stimuler et mobiliser les collaborateurs, rien ne vaut une activité qui soit centrée sur le durable. À ce titre, l’éco-conception ou l’éco-design peuvent être des moyens d’obtenir des produits plus éco-responsables : spontanément une adhésion des collaborateurs peut être observée.
Agnès Rambaud (Des enjeux et des hommes) a confirmé qu’il s’agit là d’une question de cohérence. Si on essaie de mobiliser les équipes sans modifier le fonctionnement de l’entreprise, que ce soit au niveau des politiques ou de l’innovation, cela revient à prendre des risques sociaux.
Dorothée Martin (GoodPlanet) a finalement clôturé en remerciant l’ensemble des intervenants et des participants à ce petit-déjeuner débat.
VII. Que devient la campagne 10:10 en 2011 ?
Bonne nouvelle : forte de son succès, la campagne 10 :10 se poursuit en 2011, sous la même appellation.
Nous continuons donc à inviter les entreprises, collectivités et organisations à réduire leurs émissions de CO2 de 10 % à partir de 2010 et incitons les signataires à poursuivre leurs efforts.
Selon les contraintes et les efforts déjà entrepris par les différentes structures, nous sommes conscients qu'un objectif de 10 % peut être ambitieux. Dans tous les cas, une diminution de 3 % reste le seuil minimal autorisé pour adhérer.
VIII. Bilan Carbone® de cette rencontre
Le calcul des émissions de gaz à effet de serre engendrées par la réalisation de la 2ème conférence 10:10 a été effectué par nos consultants Bilan Carbone®.
Les postes d’émissions pris en compte sont les suivants :
- L'énergie consommée lors de la conférence (chauffage et électricité),
- Le transport de personnes (organisateurs et participants),
- Les consommations du petit-déjeuner (boissons chaudes, viennoiseries, gobelets, sucre…),
- La production de badges personnalisés,
- La production de déchets.
Le total des émissions est évalué à 0,2 t CO2 eq (avec une incertitude de 23 %). Les déplacements de personnes constituent le principal poste d’émissions puisqu’ils sont responsables de 85 % du total des émissions. Les résultats pour ce poste sont néanmoins faibles grâce à un fort taux d’utilisation des transports en commun. En effet, 87 % des distances parcourues par les organisateurs et participants pour se rendre à la conférence ont été effectuées en métro, bus et train.
La production des boissons chaudes et viennoiseries offertes au petit-déjeuner constitue le second poste d’émissions (12 % du total). L’ensemble des produits utilisés lors de ce petit-déjeuner est certifié FAIRTRADE.
Les autres postes d’émissions sont peu significatifs :
- Energie consommée : 1,5 % du total des émissions
- Production de déchets directs : 0,11 % du total des émissions
- Production de badges personnalisés : 1,2 % du total des émissions.